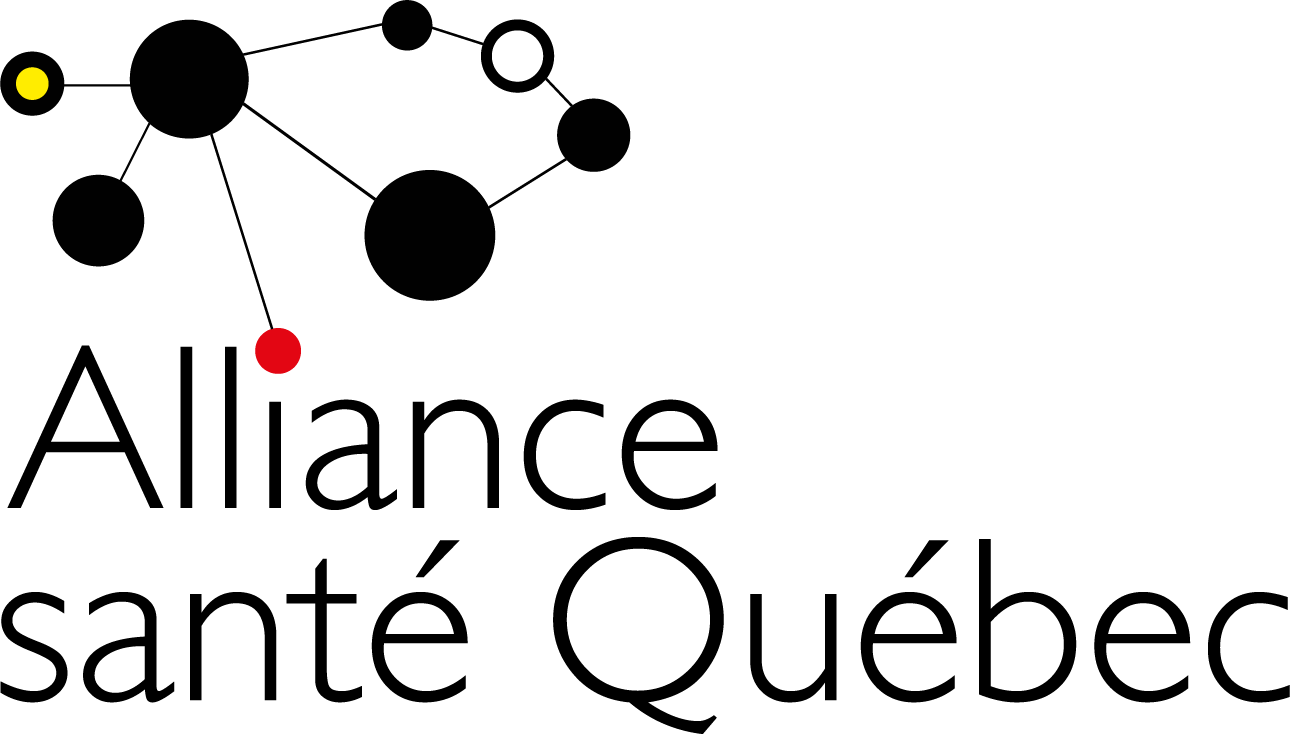Synthèse des discussions de la conférence internationale en santé durable

Des acteurs clés des villes de Lausanne, Nantes, Paris et Québec se réunissent le 3 décembre 2024 pour la conférence internationale La santé durable, vecteur de progrès socioéconomique. Animée par Valérie Borde, cette conférence internationale rassemble 250 personnes en comodalité autour d’un programme de qualité en compagnie de nombreux représentants gouvernementaux et universitaires de renommée internationale et d’acteurs clés des milieux communautaires et de la société civile, tous présents pour partager des leçons apprises et accélérer la mise en œuvre de la vision en santé durable.
L’organisation de cette conférence est rendue possible grâce au soutien financier du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, de la Ville de Québec, de l’Alliance santé Québec et de l’Université Laval, avec l’étroite collaboration de Québec International.
Cette conférence est la première activité du comité Québec, capitale internationale, mis sur pied à la suite de l’entente de diplomatie municipale conclue en 2022 entre le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) et la Ville de Québec. Ce comité réunit des représentants de la Ville de Québec, de Québec International, de l’Université Laval et du MRIF.
Une synthèse complète des discussions est disponible ici : Synthèse des discussions_Conférence internationale_Alliance santé Québec
Les enregistrements de la Conférence internationale sont disponibles sur la chaîne YouTube de l’Alliance santé Québec.